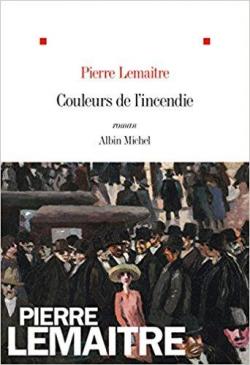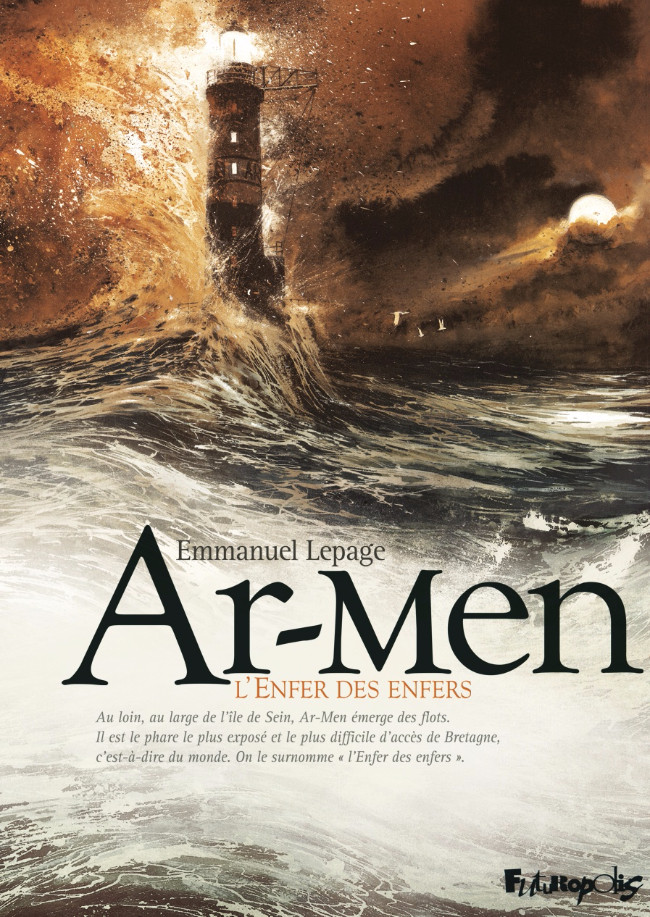Le roman de la démesure. Les chiffres
étant souvent plus parlants qu’un long discours, je vous en livre ici
quelques-uns : près de 2000 pages (pour lesquelles j’ai opté pour la
version en trois volumes), 17 parties, 337 chapitres. Dans la vie normale,
l’épilogue d’un roman se résume en quelques lignes voire quelques pages. Ici ce
sont plus de 100 pages qui concluent la fresque. On croise des centaines de
personnages (je ne les ai pas comptés, mais certaines sources font état de
500 !). L’écriture du roman s’est étalée durant sept années, entre 1863 et
1869. Dans la vie normale, un roman se lit en quelques dizaines d’heures au
maximum. Ici j’évalue ma durée totale de lecture à plus de 130 heures. Comme le
disait si justement le grand Rod SERLING en parlant de tout à fait autre
chose : « Nous voilà
transportés dans une autre dimension ».
On ne résume pas un livre qui n’est pas
résumable. L’histoire s’étend de 1805 à 1820 en Russie et raconte la destinée
de plusieurs familles bourgeoises : les Bezoukhov (dont Pierre, l’enfant
bâtard, est le héros principal du roman, et se trouve être l’un des doubles de
TOLSTOÏ), les Bolkonsky (André, l’un des autres doubles de l’auteur, est aussi
l’une des charnières de l’intrigue), les Kouraguine ou encore les Rostov.
Le titre « Guerre et paix « est
inspiré de l’anarchiste théoricien Pierre-Joseph PROUDHON (TOLSTOÏ lui-même
était anarchiste). Le mot « Guerre » devrait d’ailleurs s’écrire au
pluriel puisqu’il est question de trois guerres : celle dite de la
troisième coalition en 1805, celle de Tilsitt en 1807 et enfin la longue et
désastreuse campagne de Russie de 1812 avec l’épisode de la Bérézina. Toutes
mirent en scène principalement la Russie d’Alexandre 1er et la
France de Napoléon 1er, même si de nombreux autres pays prirent part
aux conflits. Une réflexion du Prince André Bolkonsky dès le début du livre
peut servir de trame : « Si
l’on ne se battait que pour ses convictions, il n’y aurait pas de guerre ».
Ce roman sera ponctué de très nombreuses morts, pas toutes sur les champs de
bataille d’ailleurs.
La paix : elle est vue historiquement
par la paix de Tilsitt, mais plus fictionnellement par le destin des
personnages du roman. De nombreuses histoires d’amour par le biais de
rencontres, déchirements, trahisons, adultères, etc. TOLSTOÏ a mis le paquet et
sorti les violons pour approfondir un romantisme très marqué, si certains
passages traitant des affaires de cœur, des émotions amoureuses ou de ressentis
peuvent s’avérer longs, ils éclairent pourtant sur tout le reste. Je ne dévoilerai
rien de ce point du livre, ma chronique ne ferait que vous perdre un peu plus
(si vous ne l’êtes pas déjà).
Dans cette saga d’une rare densité, c’est
aussi le personnage de Napoléon qui est mis en exergue. En mettant bout à bout
les nombreux passages concernant sa personne, on aurait sans nul doute une
biographie assez complète d’un empereur qui fascine l’Europe entière, par une
adoration doublée d’une haine farouche (il est vu sous les traits de
l’antéchrist), émanant parfois d’un même cerveau à quelques mois de distance.
TOLSTOÏ n’hésite pas à se placer en porte-à-faux de l’histoire de ces guerres
telle que racontée par les historiens officiels. Il s’en arroge le droit,
notamment car, parlant au nom du peuple russe envers ce qu’il dévoile sur la
stratégie de Napoléon, « Nous
n’avons pas, Dieu merci, pour cacher notre honte, à nous incliner devant son
génie, nous avons payé cher le droit de juger ses actes, de bonne foi et sans
déguisement, et dès lors nous ne sommes obligés à aucune concession ».
Et s’il tacle les historiens c’est aussi parce que « Le mouvement des masses n’est produit ni par le pouvoir ni par
l’activité intellectuelle, ni par l’union de l’un et de l’autre, comme le
pensent les historiens, mais par l’activité de tous ceux qui prennent part aux
événements, et qui se groupent de telle façon que ceux qui agissent le plus
directement sont les moins responsables, et réciproquement », leur
reprochant leur manque de recul et la non prise en compte d’une quantité de
causes.
Pour bien comprendre le récit historique,
il faut quand même se passionner pour les stratégies militaires qui sont explorées
ici avec force détails, telle un immense tableau chargé de microparticules
multicolores. Certaines pages peuvent paraître longues, d’autres sont tout
simplement d’anthologie, je pense notamment à la campagne de Russie et de ses
incendies gigantesques de Smolensk et Moscou.
Mais le plus beau reste à venir, et rien
que pour cela il vous faut parvenir à la conclusion du vertigineux
ouvrage : l’épilogue. Plus de 100 pages en version essai sur la notion de
guerre, de paix, de liberté et de nécessité, ce moment est proprement divin, il
termine un bouquin d’une variété extrême. Pour TOLSTOÏ (et il va implacablement
le démontrer), la liberté totale n’existe pas, elle n’est que relative. Il en
est de même pour la nécessité. Cet épilogue fait à coup sûr partie des grandes
émotions de la littérature mondiale de par son développement, sa précision, les
exemples pris, on en ressort éreinté mais convaincu.
Il est indéniable que lire « Guerre
et paix » est une sorte de défi lancé à soi-même. Tout en lisant de
manière soutenue et quotidienne, il ne m’a fallu pas moins de cinq semaines
pour voir apparaître le mot « fin ». Et comme après chaque longue
expérience littéraire, je me retrouve un peu à poil après une telle aventure,
car bien que n’étant pas téméraire, pour moi le fait de terminer « Guerre
et paix », c’est un peu comme descendre les chutes du Niagara en caisse à
savon. C’est aussi un défi par les patronymes utilisés par l’auteur :
certains personnages portent le même prénom, des noms de familles sont presque
similaires (les Karaguine et les Kouraguine).
Le plus incroyable dans tout cela, c’est
que TOLSTOÏ a écrit plusieurs versions de ce roman fleuve (et je ne dis pas
cela pour la seule Bérézina qui d’ailleurs est une rivière) ! Pour la
présente version, visiblement la plus usitée, j’ai choisi la traduction d’Irène
PASKEVITCH, qui semble toujours faire autorité dans le domaine puisque son
travail est encore réédité de nos jours.
Je parlais de démesure au début de cet
article : ce roman a amené des liesses populaires ou individuelles hors
norme, à la hauteur de ce qu’a écrit TOLSTOÏ : récemment en Russie, une
lecture publique de 60 heures non stop a eu lieu, je me souviens aussi de cette
anecdote (je n’ai malheureusement pas pu retrouver la source) d’un homme qui a
envoyé « Guerre et paix » en SMS à sa fiancée. Dans mon souvenir, et
à raison de nombreux SMS quotidiens, l’aventure a duré plus d’un an. Pour
finir, cette petite anecdote contée par une amie : sa grand-mère alors
impotente ne quittait plus son fauteuil aménagé, elle a passé les dernières
années de sa vie à lire, refermer et reprendre du début « Guerre et
paix ». Avec un roman pareil, la raison n’existe plus, les réflexes
rationnels sont oubliés au profit d’actions d’envergure dans le temps.
« Guerre et paix » est considéré que le plus grand roman russe
historique : le travail effectué par TOLSTOÏ pour le rédiger ne peut que
nous amener à nous incliner devant ce gigantesque rendu. Pour la compétition,
on reviendra plus tard. Je termine aujourd’hui ce roman et je me sens comme
groggy ou migraineux un jour de gueule de bois, avec cette question :
comment peut-on entreprendre un travail littéraire aussi acharné, surdimensionné ?
D’ailleurs, cette question mérite-t-elle même d’être posée ? Quoi qu’il en
soit, il me va falloir reprendre une vie normale après cette expérience hors du
commun, atterrir de nouveau dans la vraie vie, ce qui devrait encore prendre
quelques jours.
(Warren
Bismuth)