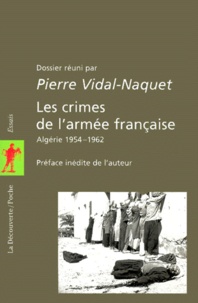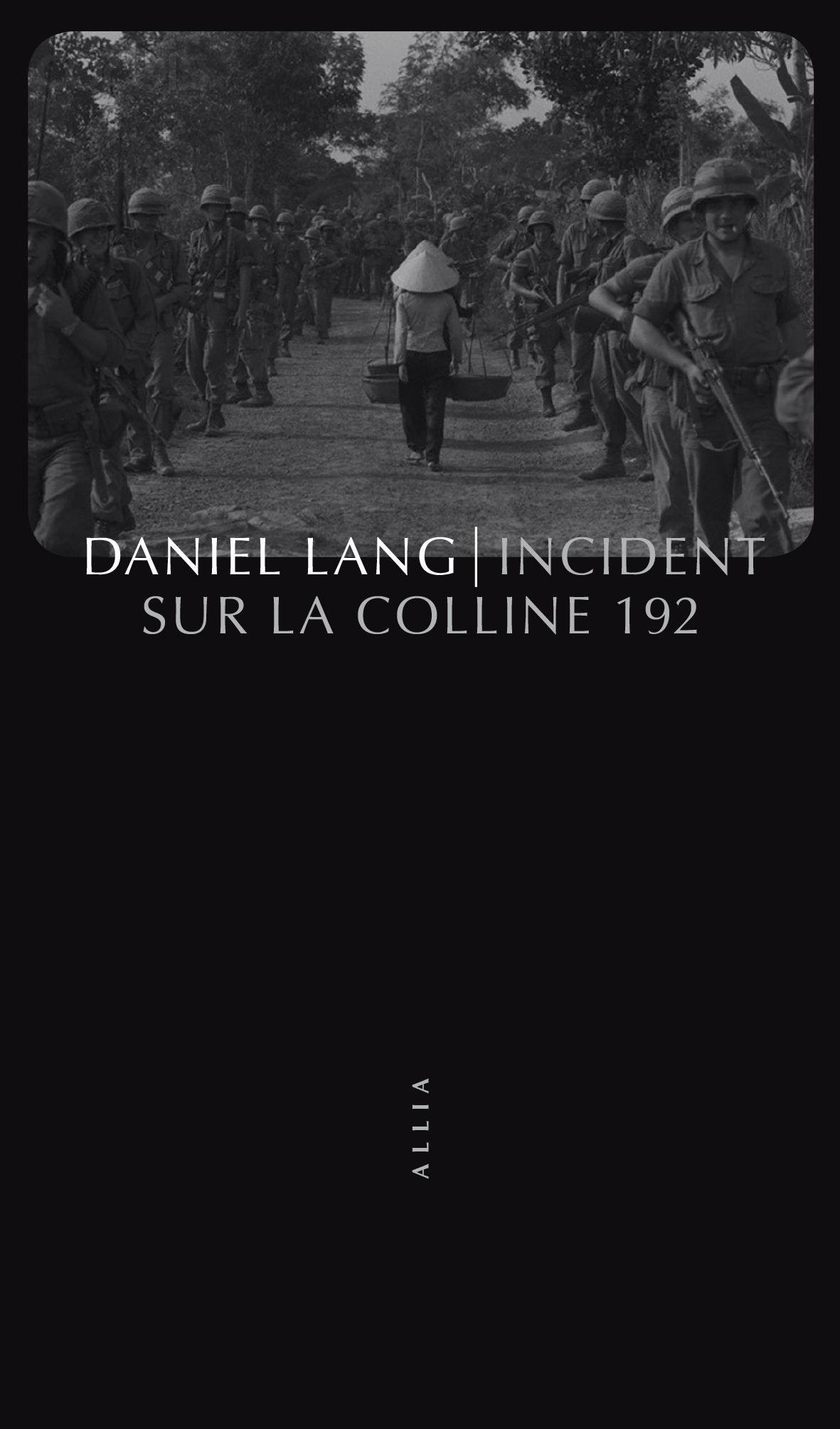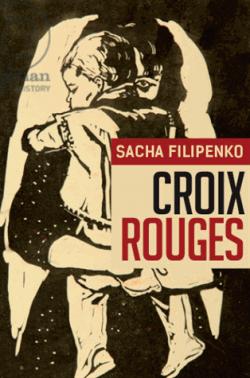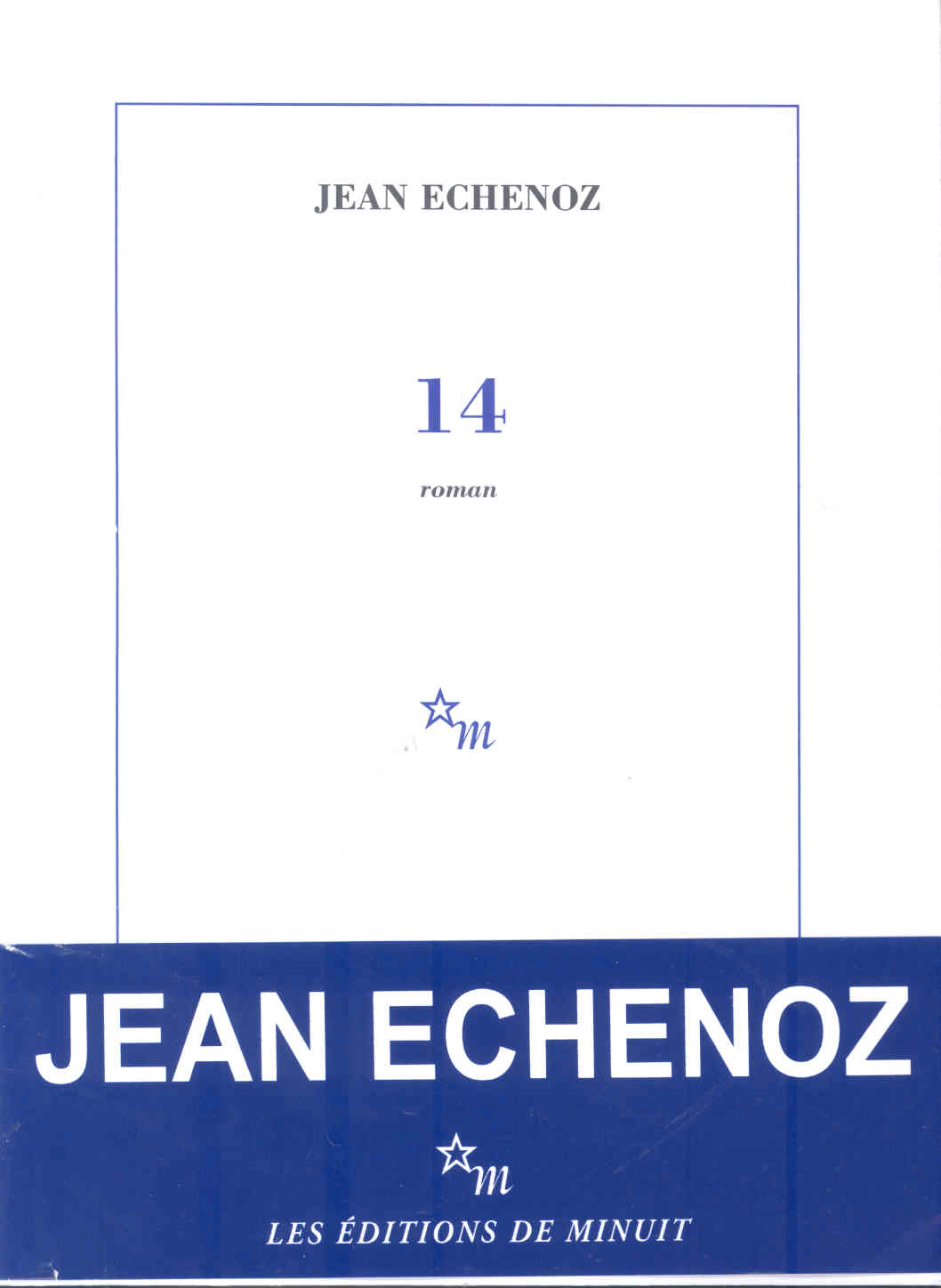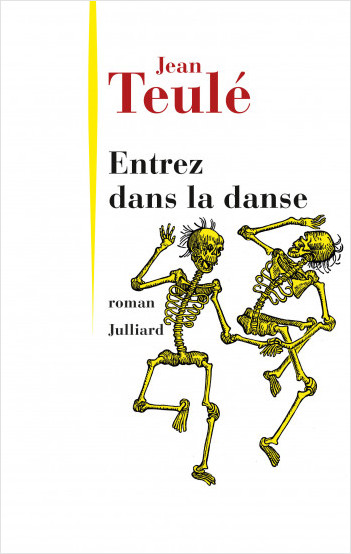Trois pièces de théâtre, trois périodes
distinctes de l’Histoire de France, trois face-à-face d’envergure. Joie.
« Le souper » : créée en
1989, elle met en scène FOUCHÉ et TALLEYRAND en 1815, après la chute de
NAPOLÉON 1er et alors que FOUCHÉ est Président du gouvernement
provisoire. TALLEYRAND est pour un retour de la monarchie après l’épisode
napoléonien (pourquoi pas un Louis XVIII sur le trône ?) tandis que FOUCHÉ
se déclare pour la République. Un entretien qui dévie sur les exactions passées
des deux personnages. « Vous savez
ce qu’est un mécontent, FOUCHÉ ? C’est un pauvre qui réfléchit ».
Adaptée au cinéma en 1992 par Edouard MOLINARO.
« L’entretien de M. DESCARTES avec M.
PASCAL le jeune » : comme son nom l’indique, face-à-face avec le
« vieux » DESCARTES de 51 ans contre un jeune Blaise PASCAL de 24 ans
déjà éreinté par la vie et malade. Entretien imaginaire de 1647 sur la
philosophie, la vie, Dieu, les souvenirs, l’Histoire, et bien sûr des dialogues
tendus sur le thème de la religion qui les oppose. Pièce créée en 1985.
« L’antichambre » : encore
un dialogue imaginaire censé se tenir en 1750 (et créé là en 1991) entre deux
salonnières parisiennes : l’assez défraîchie Madame Marie du DEFFAND et la
toute jeune espiègle et prometteuse Julie de LESPINASSE avec parfois en
arbitrage l’amant de la première, le Président HÉNAULT. Un face-à-face d’une
grande violence entre deux dames que tout oppose, sauf l’immense opportunisme. Il
sera question de l’affaire CALAS, de religion, mais aussi de l’Encyclopédie que
préparent DIDEROT et D’ALEMBERT. Les deux femmes, dans un véritable duel, vont
mener un cruel jeu de joutes oratoires (Julie :
« Je vous plains », Marie : « Tenez-vous-en à l’insolence,
elle vous convient mieux que la pitié »).
Trois pièces de théâtre d’allure classique
et de haut vol par le ton et les dialogues cisaillés et parfaitement documentés
pour replonger dans trois siècles différents mais avec des enjeux parfois
similaires. Il est difficile de ne pas faire le rapprochement avec l’excellente
émission télé historique française des années 1950 et 1960 « La caméra explore
le temps » (retirée de l’antenne en 1966 pour avoir dressé un portrait
trop positif (donc déplaisant au pouvoir gaulliste) des Cathares, mais ceci est
une autre histoire). Donc forcément, on se régale si tant est que l’Histoire de
France et ses vicissitudes nous intéressent. Trois pièces remarquables et très
agréables à lire, ici compilées en un volume en 1994.
(Warren
Bismuth)