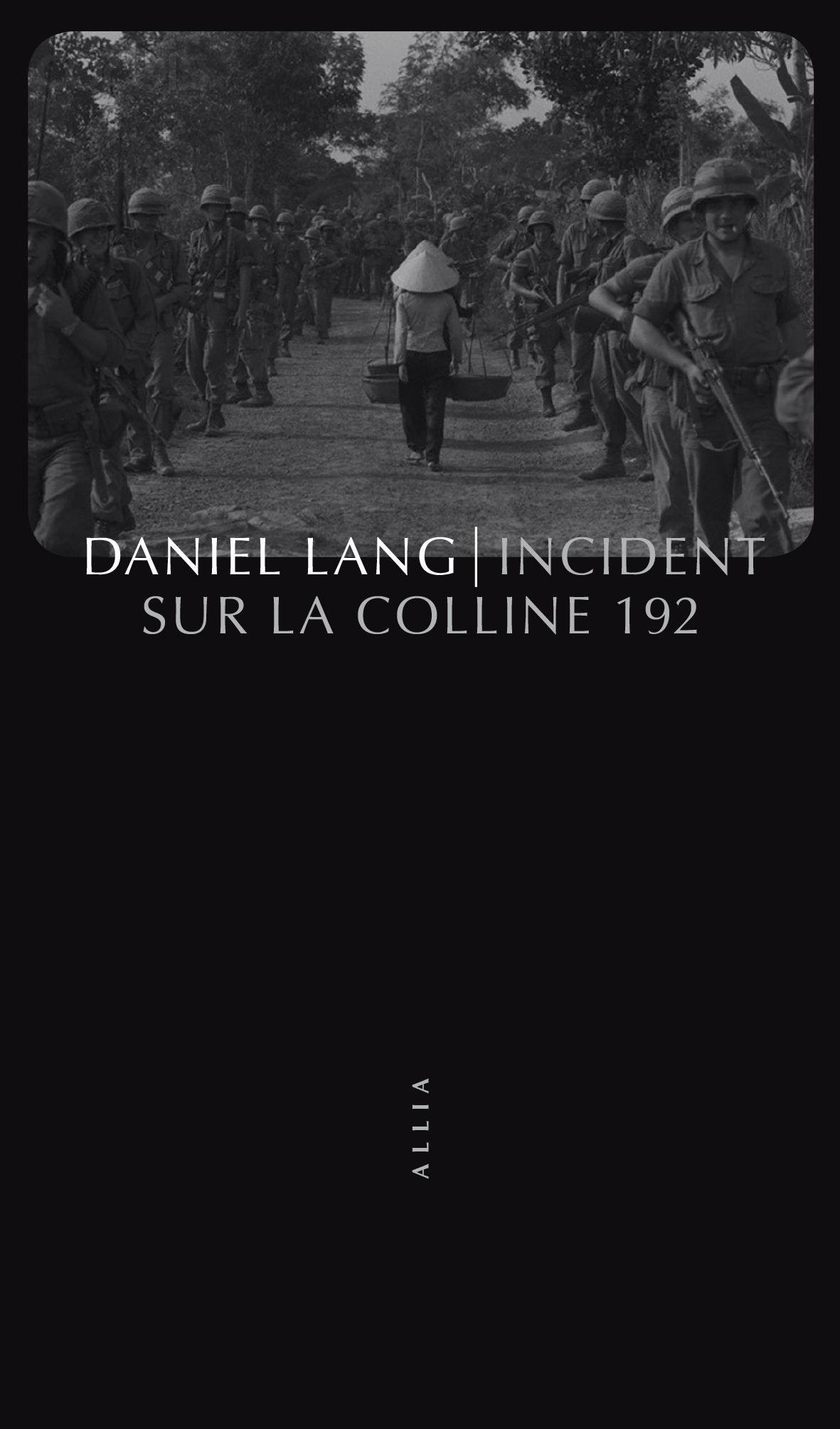Doug PEACOCK est une figure hors norme qui, après une expérience traumatisante à la guerre du Vietnam, est parti explorer les grands espaces – Etats-uniens surtout – méconnus de l’humain. Proche ami de Edward ABBEY, il fut son compagnon de randonnées longues et éprouvantes. Dans ce livre à multi facettes, il se dévoile sans fard.
Infirmier au Vietnam durant la guerre tristement célèbre, engagé volontaire dans les Bérets verts fin 1966 pour un an et demi (il restera écorché vif et hanté par cette période), il décide à son retour de se consacrer à la nature sauvage. En 1969, un an après son retour de l’enfer, il rencontre Edward ABBEY, militant éco-saboteur anarchiste lui aussi, de quinze ans son aîné, un ABBEY pour qui « Chacun de nous doit donner un sens à sa vie ».
PEACOCK va voir mourir ABBEY, il va même l’aider en ce sens, il fera partie de l’équipe de très proches qui l’enterreront, illégalement, en plein désert. Il pousse la pudeur jusqu’à ne pas dévoiler le lieu exact de l’inhumation, un vœu de son ami. ABBEY est en quelque sorte le héros malheureux de ce récit de vie, par ailleurs riche en thèmes et en réflexions. ABBEY a marqué PEACOCK à tout jamais, aussi ce dernier lui rend un hommage appuyé, en esquissant une biographie militante de l’écrivain révolutionnaire.
L’intelligence de PEACKOCK l’amène à ne pas tourner en rond, il glisse d’habiles et nombreux éléments autobiographiques. En outre, il connaît parfaitement la Nature, alors autant nous en faire profiter : longues tirades sur la faune, la flore, les espèces d’oiseaux qu’il observe, seul ou avec Edward, lors de ses longs périples, le voyage vire à l’encyclopédie, nécessaire pour comprendre le comportement humain. Comme ABBEY, PEACOCK se sent anarchiste, mais pas de cette image appartenant à l’imaginaire collectif. Lui, il est anar par son individualisme, son isolement, sa volonté de solitude, par son refus du progrès à tout prix, par son autonomie, par sa fusion avec la nature sauvage, à laquelle il s’identifie en la respectant au-delà du possible.
L’Histoire des Etats-Unis est abordée, notamment par le biais d’ancestrales tribus « indiennes », car PEACOCK est passionné par le mode de vie des Autochtones, il en dresse ici un portrait tendre, documenté. Et puis ce roman d’ABBEY, le premier, qu’il voit d’un mauvais œil, ce « Gang de la clé à molette », où le héros, Hayduke, est le double un poil maladroit et naïf d’un certain PEACOCK Doug jeune. Par ce livre, il découvre des traits de sa personnalité qu’il ignorait, même s’il sait pertinemment que ABBEY l’a volontairement forci, ce trait. Hayduke représente d’ailleurs pour PEACOCK le parfait crétin.
Miné par la vie, désillusionné, PEACOCK entreprend de longues marches pour combattre cet « état de stress post-traumatique officiellement reconnu, syndrome du vétéran, syndrome de déficit d’attention, syndrome de la Tourette marginal, tendance à la dépression, trouble de la personnalité borderline, plus un lourd passé d’alcoolique. Les types dans mon genre ne deviennent pas des maîtres zen ». Pour s’en persuader, il se rend au Népal. Plusieurs chapitres disséminés ici et là en font foi.
ABBEY, malade, et PEACOCK, le camarade à l’oreille attentive mais pas toujours en harmonie, dissertent sur le suicide. Bref moment intense : « Songer au suicide n’est pas la même chose que s’apprêter à le commettre. Ed avait les idées claires sur la question : il approuvait le suicide, même s’il déplorait les dommages collatéraux infligés au survivants ». C’est lorsqu’il se sent au plus mal que PEACOCK convoque la mémoire de ABBEY dans son esprit, c’est ABBEY qui, par sa force colossale, le fait avancer.
Descriptions des animaux (PEACOCK est un spécialiste hors compétition des grizzlys, voir son œuvre « Mes années grizzly »), des paysages à couper le souffle dans tous les sens du terme, de la flore, détails minéralogiques, point archéologiques (car PEACOCK, en athlète complet, est aussi archéologue à ses heures perdues). Ce bouquin est d’une variété et d’une force redoutables. Retour aux atrocités de la guerre, celles qui ont construit un PEACOCK à la fois combatif et fébrile, radical et sombre, qui ne parvient pas toujours à assumer sa vie de famille (dans ce livre, il revient sur son divorce). C’est un homme cabossé qui se présente devant les paysages majestueux de l’Utah, de l’Arizona, les canyons prodigieux, la terre non souillée par la présence humaine. Mieux que quiconque, il sait décrire ces paysages, une autre immense qualité de ce récit. Nous nous surprenons à chercher sur la toile les photos des montagnes, des canyons dont il nous entretient. Arrêt aux Roches rouges de l’Utah (alors qu’il est recherché par la police), à l’endroit même où ABBEY a rédigé « Désert solitaire ».
Il est évident que, pour la partie biographique de ABBEY, PEACOCK a voulu affiner particulièrement les derniers jours de son pote. Il les évoque avec tendresse et émotion, lui qui l’a suivi jusqu’à son dernier souffle, avant de l’enterrer (avec la dernière lettre qu’il lui a adressé). PEACOCK réalise l’amitié débordante et inestimable qu’il avait pour ABBEY une fois ce dernier mort. Dur avec lui-même, PEACOCK se veut lucide, sans violons ni guimauve. Il ne passe pas sous silence la maladie de son cher Ed, qui se savait condamné à court terme, et qui est allé jusqu’au bout de ses forces, dans un combat inégal et ô combien acharné, avant de s’éteindre au milieu du désert en 1989.
« Le gang de la clé à molette » de ABBEY (1975) fut un tournant dans la littérature engagée, se vendant à des dizaines de milliers d’exemplaires et influençant grandement la pensée écologiste (toujours vivante et active aujourd’hui), à la base de la création de l’association Earth First !
Ce texte époustouflant, vrai, est teinté de spiritualité, notamment lorsque PEACOCK découvre les pétroglyphes laissés par de lointains Autochtones, doté d’une puissante introspective et mâtiné de philosophie de vie centrée sur l’essentiel, totalement débarrassée du superflu. L’humilité tient une place prépondérante dans ce texte : « On est ici au cœur des terres sauvages et de la nature, on y est de tout son être. On n’a pas d’autre choix, en ce royaume, que de se fondre dans le flux ancestral de la vie. Ce n’est pas le genre d’endroit où l’on tient à loisir le journal de ses aventures et de son retour aux sources ».
En fin d’ouvrage, PEACOCK entreprend une longue marche en guise d’hommage, une randonnée que ABBEY n’a jadis jamais pu terminer. Il se remémore une fois de plus leur amitié indéfectible, ces deux rebelles évoluant presque main dans la main, ABBEY divorcé trois fois et grognon, ronchon, parvenu au bout du voyage. PEACOCK tourne les pages des carnets d’un ABBEY en fin de vie. Séquence émotion. Car son ami se dévoile, évoque la souffrance physique et la mort prochaine, plusieurs années avant qu’elle le terrasse.
Parallèlement, PEACOCK entreprend la lecture du dernier roman écrit par son vieil ami : « Le retour du gang », dans lequel réapparaît Hayduke, son double détesté. Il n’en confie pas un mot, comme pour pudiquement faire comprendre qu’il n’adhère pas à ce personnage.
Publié originellement chez Gallmeister en 2008 dans la somptueuse et malheureusement défunte collection « Nature writing » (à coup sûr l’une des plus belles et savoureuses collections jamais parues en France), ce récit s’intitulait « Une guerre dans la tête », titre peut-être pas si judicieux, vu que la guerre n’est pas si présente en ses pages, n’étant là que pour expliquer la suite, les troubles de la personnalité notamment. Cette réédition, en poche cette fois-ci dans la collection Totem, fraîchement sortie des presses, se nomme plus justement « Marcher vers l’horizon ». Inspiration directe à aller chercher du côté des carnets d’un certain Edward ABBEY qui écrivait : « TRISTE… CONDAMNÉ. Consumé dans l’autoflagellation. Amertume. Dégoût face au monde littéraire, politique, artistique. Ça me donne envie de marcher jusqu’à l’horizon, de trouver un canyon confortable, de m’allonger, de me recroqueviller, de disparaître… ».
À 80 ans, Doug PEACOCK continue à célébrer le souvenir de son vieux pote, son frangin. Deux personnages incontournables du nature writing Etats-Unien, deux esprits libres de cette nature. Ce témoignage possède une force quasi surhumaine, fait partie de ces récits de vie puissants et inoubliables, il est le porte-parole de deux vies de combats, parallèles et complémentaires. Et il nous fait regretter amèrement une fois de plus la disparition de cette collection incontournable de chez Gallmeister. Il est traduit par Camille FORT-CANTONI et se révèle un chef d’œuvre du genre. À découvrir entre deux livres de Edward ABBEY par exemple, par souci de complémentarité, il est à coup sûr l’une des rééditions fleuve de 2022.
(Warren Bismuth)