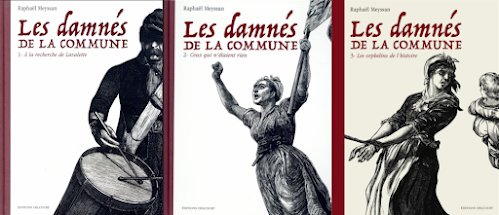Ce recueil de nouvelles est bien étrange, comme son titre le laisse présager. Ici pas question de rester les pieds sur terre, et nous allons même parfois flirter avec le fantastique. Six autrices contemporaines offrent chacune un récit, une nouvelle. Trois d’entre elles s’appuient sur des références littéraires, trois autres vont partir de leur seule imagination.
Pour les premières, nous retrouvons la nouvelle intitulée « Une robe couleur de souffrance », où Clara DUPUIS-MORENCY part de « La marquise de Sade » de RACHILDE, femme fascinée par la violence, dans un long poème gothique en prose et empli de souffrance. Hélène FRAPPAT s’inspire de la vie de Mary SHELLEY (la créatrice de « Frankenstein ») au XIXe siècle dans un récit fort et sombre, « Cette nuit ne finira donc jamais », où elle revient sur la mort de la mère de la petite Mary lorsque celle-ci n’a que 11 jours, cette même Mary qui, une fois adulte, perd son enfant et se voit en meurtrière. Doublement. Marie COSNAY choisit le classique « Les hauts de Hurlevent » de Emily BRONTË pour dresser un parallèle entre ce qu’elle y a lu adolescente et les échos avec son propre parcours dans les Landes. Un texte exigeant, qui convoque par exemple Énée et Didon.
Les trois autres textes, de pure invention ceux-ci, sont aussi signés par trois autrices. « La femme du fleuve » de Caroline AUDIBERT est un récit glacial où un violent orage tourne au déluge sous lequel se trouvent notamment deux véhicules. Le style de cette nouvelle est puissant et proprement apocalyptique, c’est celui qui entame le présent recueil.
Dans « Jaune vif, veiné de noir », Bérengère COURNUT présente une forêt onirique aux débuts de la création avec une créature mi-animale mi-minérale, dans un texte obscur, préhistorique et savamment mythologique.
Le recueil se clôt sur « Niglo » de Karin SERRES, un autre texte fort curieux où des translucides vivent dans un aquarium de laboratoire humain, celui des « nage-pas ». Les translucides sont avant tout utilisés pour servir de réservoirs à organes. Karin SERRES se plaît à nous plonger à la fois dans l’aquarium ainsi que dans un univers énigmatique.
Vous
l’aurez compris, c’est le style fantastique qui prime ici, comme le laisse
d’ailleurs présager la couverture datée du recueil. Bien que différents, les
six textes choisis ont tous ce point commun de nous balader entre réalité
possible, passé supposé et déformation du réel, interprétation. Ils sont à la
fois imprégnés d’un gothique cher au XIXe siècle tout en restant très modernes
sur la forme, tous avec une forte dose de poésie comme désespérée (pas
toujours), ainsi que féminisme parfois sous-jacent. Ce livre sorti en 2020 aux
éditions du Typhon en pleine pandémie est peut-être passé un peu inaperçu, il
vaut le coup de faire un petit détour, ne serait-ce que pour les six écritures
très accrocheuses des autrices ici présentes, et leurs univers originaux et
désarmants, univers rendu plus distendu encore par les dessins de Jérôme MINARD.
https://leseditionsdutyphon.com/
(Warren Bismuth)