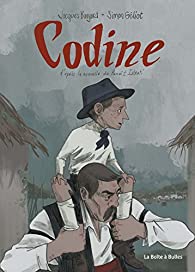Les
Poèmes à planter des éditions Le Ver à Soie situées dans les Yvelines sont une
collection fort singulière. Ce sont de petits livres renfermant chacun un court
poème dont la plupart sont tombés dans le domaine public. Mais les pages - à
découper – en papier mûrier peuvent se planter dans le sol ! En effet,
elles gardent prisonnières en leurs fibres de petites graines ne demandant qu’à
éclore. Ce « papier à ensemencer » est fabriqué à partir de graines
qui pourront germer puis fleurir ! Le processus à suivre est le
suivant :
1/ Apprenez par coeur ou écrivez votre poème
2/ Posez-le sur de la terre ou dans un pot
3/ Recouvrez-le d'une fine couche de terre
4/ Arrosez tous les jours en récitant
5/ Des pousses de mots apparaissent
6/ Vos maux se muent en fleurs.
Cinq sortes de graines sont utilisées, mais
une seule en une centaine de semences pour chaque œuvre : coquelicots,
carottes, myosotis, fleurs des champs ou salades variées.
VERLAINE,
BAUDELAIRE, LAMARTINE, RIMBAUD, HUGO, du BELLAY sont les auteurs classiques
choisis, mais sont également présents des auteurs actuels : Dominique
BARREAU, Clara Rose DELANGE, Jennifer LAVALLÉ, Gilles WALUSINSKI ou encore Juliette
KEATING.
Il est possible
de créer son propre poème en commandant chez l’éditrice le papier de la graine
que l’on désire faire pousser. À ce jour, une quinzaine de titres sont
disponibles en plus des versions à créer soi-même.
À la
même adresse sont également disponibles des petits livres de recettes à
planter. L’éditrice Virginie SYMANIEC déborde d’imagination pour proposer des
formats originaux où la lecture est le socle essentiel. Le Ver à Soie est une
maison d’édition engagée et résolument indépendante. D’autres collections, plus
« classiques », sont disponibles. Chaque livre est un petit bijou
esthétique, et le fond toujours très pertinent. Le premier livre présenté par
Des Livres Rances en 2021 sera un récit de cette maison d’édition (un petit
bijou soit dit en passant), c’est dire si je prends les choses au
sérieux !
Un livre
ne doit pas uniquement dégager une activité passive. Ces poèmes à planter
servent aussi à embellir votre environnement sans le polluer, ces œuvres (le
terme « objet » me déplaît beaucoup dans le cas présent) sont d’une
beauté incontestable. L’originalité se lie au geste environnemental et au
militantisme, tout en pouvant se délecter de poésie, difficile de trouver
meilleure recette.
Le Ver à
Soie publie des romans, récits de vie, livres destinés à la jeunesse, tous
guidés par un esthétisme à couper le souffle. Allez voir le catalogue, il est
varié mais jamais détaché de la lutte pour la culture, la littérature et
l’indépendance. Vous aurez peut-être la chance de croiser Virginie SYMANIEC sous
son barnum rouge au gré de vos déplacements sur les marchés. Car oui, en plus
elle avale les kilomètres pour présenter et vendre elle-même ses publications.
À ce point-là ce n’est plus un métier mais un sacerdoce !
(Warren Bismuth)