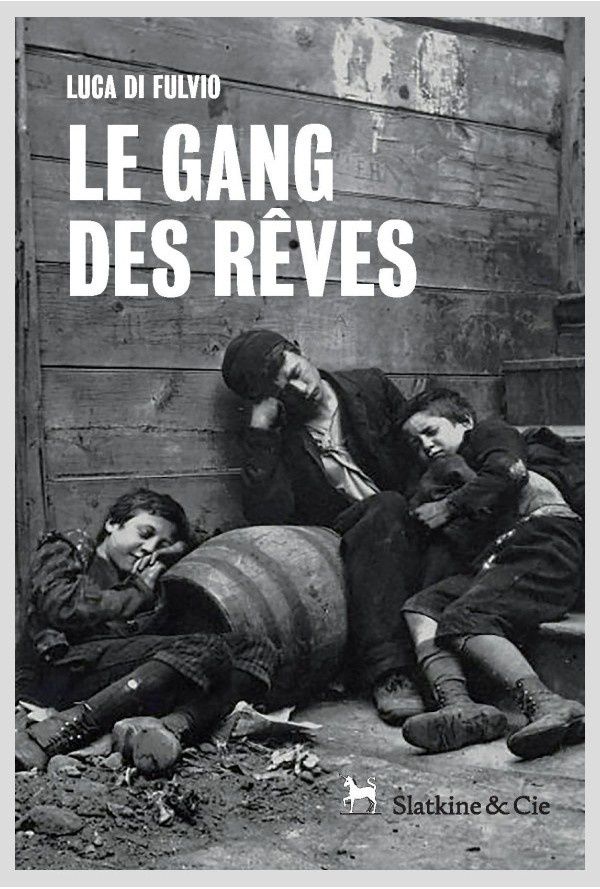Planquez vos vessies car voici le messie !
Avant de présenter ce bouquin qui me tient particulièrement à cœur (vous
comprendrez plus loin pourquoi), il est nécessaire de regarder dans le rétroviseur.
Après l’avènement du punk-rock en 1976/1977 chez les britanniques, la France a
été touchée à son tour, et si la première vague s’est écrasée contre un piton
rocheux, la deuxième déferla dès le tout début des années 1980, avec ses
groupes bien sûr, mais aussi ses labels, ses lieux de concerts, ses
distributions indépendantes (on ne disait pas encore trop D.I.Y.), ses
compilations cassettes (oui oui, ça paraît néanderthalien, des cassettes à
bandes messieurs-dames !), et bien sûr sa presse underground : les fanzines.
Parmi ceux-ci, un titre particulièrement représentatif d’une époque, d’un
mouvement : GABBA GABBA FUCK ! Commis à Clermont-Ferrand à partir de
1983, il semblait pourtant ressembler aux autres fanzines français. En
apparence seulement. Car il allait à mon goût beaucoup plus loin dans cette
sorte de provocation incessante qu’était le punk (ce qu’il est par ailleurs
resté, peut-être de manière plus « mûre »). Le punk c’était de sales
gosses qui aimaient jouer avec leur morve et les bouteilles de Valstar (non
consignées je précise), ainsi qu’avec les nerfs des gens, des ados révoltés qui
reprenaient un slogan, une éthique venus d’Angleterre et des Etats-Unis. Jusque
là on est d’accord. On est d’autant plus d’accord que c’est moi qui écris
l’article. Là où GABBA GABBA FUCK ! se démarque, c’est dans l’excès :
si les mises en page de l’époque étaient confuses, celle de ce zine était
éminemment chaotique, d’une part car le rédacteur en foutait dans tous les
sens, mais aussi découpait des articles un peu partout sur la feuille pour les
coller n’importe où, ce qui rendait le tout quelquefois proche de l’illisible,
mais il poussait le vice jusqu’à avoir supprimé l’interligne de la machine à
écrire (oui, on écrivait avec un stylo ou une machine à écrire, photoshop et
compagnie n’étaient même pas encore dans le ventre de leur mère), ce qui
donnait une écriture si serrée que les lignes se chevauchaient.
Explication : GABBA GABBA FUCK ! était gratuit, et comme le rédacteur
l’explique dans l’introduction du livre, il voulait placer un maximum de
lecture en un minimum de place, comme on bourre avec ses pieds un tiroir rempli
de chaussettes (quelle idée de posséder autant de chaussettes). Pour lui, le
lecteur pouvait bien faire l’effort de démolir ses yeux puisqu’il n’avait pas
payer la chose (contrairement au rédacteur). Une réflexion qui se défend.
Toujours dans l’édito, mais aussi dans la conclusion du livre, Laurent, le seul
représentant de ce zine, expose ses souvenirs sur la difficulté à l’époque de
faire des photocopies à peu près propres, avec le toner qui dégueule sur les
copies, les recto-verso qui coincent, les photocopieurs qui lâchent, les
feuilles qui gondolent, etc. Croyez-moi si vous voulez, mais pour avoir vécu
ces expériences moi-même, je puis certifier qu’il n’exagère pas une seule
seconde. Mieux, il ramène des souvenirs jusque là enfouis dans ma mémoire, quel
talent ! Maintenant que vous avez la forme (enfin, l’absence de forme
devrais-je dire), analysons le fond : G.G.F. parlait de punk, était fait
pour les punks. Pour le recevoir, il suffisait d’envoyer une enveloppe timbrée
(tout comme son rédacteur). Les pages débordaient (le mot n’est vraiment pas
trop fort) de chroniques, infos, dates de sorties de disques, adresses de
groupes, labels, fanzines, organisations, tout ceci à l’international (on
apprenait entre autres l’existence d’une scène punk en Afrique du sud). À
partir du n°5, des interviews de groupes apparaissent. Les chroniques de G.G.F.
prenaient la majorité de la place, il y en avait dans tous les sens, impossible
de ne pas souffrir d’un torticolis en fin de lecture d’un numéro. Je
précise : le numéro sort à l’origine en double A4 recto-verso, ce nombre
de 4 feuilles ne sera pas toujours respecté par la suite. G.G.F. était à la
pointe de l’actualité en sorties de disques, était l’un des premiers fanzines
français à parler d’anarcho-punk (un mouvement qui a fait son chemin depuis).
La majorité des disques punks français sortis à cette époque étaient chroniqués
dans ses colonnes, ponctués de « fuck », de « oi », et on
croit entendre quelques rots par-ci par-là. G.G.F., c’est peut-être LE fanzine
punk à étudier pour une thèse sur le fanzinat des 80’s, rien ne manque, ni le
bordel, ni la présentation extrême, ni le « jmenfoutisme »
revendiqué, c’est une perle rare. Vous vous dites « oui mais l’auteur de
cette chronique a dit au début que ce livre lui tient particulièrement à cœur,
aussi on souhaiterait bien savoir pourquoi ». C’est exact, vous êtes très
pertinents ce soir. Désolé si je reviens un peu sur mon parcours personnel
(vous pouvez sauter les lignes qui suivent, je ne vous en tiendrai pas rigueur.
Quoique…). 1986, je suis un jeune punk ignorant, ne connaissant que les groupes
assez « importants » du mouvement punk. Au tout début de la sainte
année 1986 (février je crois), je tombe nez à nez avec une affiche dans un
magasin de disques : il y est question d’une émission punk sur une radio
indépendante. Le nom de l’émission est « Media blitz ». Dans mon
souvenir elle est diffusée le lendemain de ma rencontre avec son affiche. Je me
branche sur ma radio pourrie (le son l’était également), et là ma vie bascule à
jamais : j’entends du punk du monde entier, des trucs dont je ne
soupçonnais même pas l’existence. L’animateur de cette émission annonce qu’il édite
un fanzine (mais qu’est-ce donc ???), qu’il est gratuit. J’envoie une
enveloppe timbrée, vous connaissez la suite. Mes premières vraies
correspondances avec des activistes punks (à une époque où écrire se faisait
sur du papier et où La Poste s’appelait les P.T.T.), les premières cassettes
que j’ai reçues le furent aussi suite à des chroniques parues dans ce fanzine.
Je suis resté en contact quelque temps avec Laurent, pas assez à mon goût, mais
son influence quoique involontaire fut majeure dans mon existence. Il y a
quelques mois, ce diable ressort de sa boîte en annonçant qu’il vient de sortir
un livre constitué de l’intégrale d’un fanzine Strasbourgeois (basé à Aurillac
à l’origine) de 1982/1983, du nom de FRACTION WAW UN-LIMITED, zine dont le nom ne
m’évoque plus rien. Bref, je me plonge dans ce bouquin avec délectation, les
souvenirs et la bouille de Laurent remontent dans mes entrailles. À peine remis
du choc, je reçois un colis, par les PT.T., comme jadis, avec un livre en papier
dedans. Mazette ! L’intégrale de la première époque du zine qui m’a vu
« grandir », GABBA GABBA FUCK ! Les larmes aux yeux, j’en entame
la lecture et les souvenirs reviennent, avec ce gros fond de tendresse, d’une
époque où l’on était jeunes, casse-cous (pour ne pas dire plus), où la vie nous
semblait éternelle et où l’on donnait toute notre énergie (et notre fric accessoirement)
au punk. Ce livre est l’intégrale des 8 premiers numéros de GABBA GABBA
FUCK ! et il est magique, car comme je l’ai déjà écrit, l’édito et la postface
sont un condensé du fanzinat et de ses difficultés techniques dans les 80’s,
mais ces 8 premiers numéros de G.G.F. sont une radiographie assez exacte du
punk français de la décennie estampillée 80. Laurent se sabordera pourtant à
l’issue de ce n°8. Mais bien sûr, il ne pouvait pas rester sans rien faire,
aussi quelques mois plus tard, il reprendra G.G.F. en split fanzine (un zine
jusqu’à la moitié de l’ouvrage, un second sur l’autre moitié) avec DEAD FUCK
COMMANDO, toujours gratuit. Petite précision utile : DEAD FUCK COMMANDO
était aussi l’œuvre de Laurent. C’est par le premier numéro de D.F.C. (pas
encore en split avec G.G.F., il le deviendra à partir du numéro suivant, ce
jusqu’à l’arrêt de ses activités fanzinesques, en 1989) daté du second semestre
1985 que l’aventure réellement punk underground commence pour moi (même si
j’animais déjà une émission de radio). C’est en effet le premier zine que j’ai
eu entre les mains. Et Laurent, tu as très bien vu dans ta postface, car en
effet, des lecteurs lisaient tout jusqu’à la dernière ligne. J’en faisais
partie. Merci pour ce moment. Dans ce livre, outre les formidables préface et
postface, vous pourrez vous délecter jusqu’à en devenir aveugle – au sens
premier du terme – des 8 premiers numéros de G.G.F. (de septembre 1983 à
décembre 1984), mais aussi de toutes les couvertures (1985-1989) du split
fanzine G.G.F./D.F.C. Et en bonus vous aurez même devant vos yeux ébahis les 4
jaquettes des compilations cassettes que Laurent a sorti entre 1985 et 1986 sur
son micro-label « Ethylik tapes », ainsi que la couverture d’une
nouvelle écrite en 1984 par l’un de ses amis à l’époque par ailleurs membre du groupe
punk aurillacois MALADIE WARGASM. Attention, la présente édition n’est tirée
qu’à 100 exemplaires, et comme Laurent est un vrai fou furieux comme on en fait
plus, le tout est… gratuit ! Oui, comme à l’époque de son fanzine, sauf
que là c’est un livre. De 100 pages. Remerciements éternels. Pas moins. Une
bière sera utile. Comme avant. Vous pouvez tenter votre chance afin de recevoir
la bible (ah mince, je me plante, « La bible » était un autre fanzine
des années 80, de Clermont-Ferrand également) en contactant Laurent par le
biais suivant (à la même adresse vous pouvez commander le livre FRACTION WAR
UN-LIMITED pour la modique somme de 18 euros) :
(Warren
Bismuth)