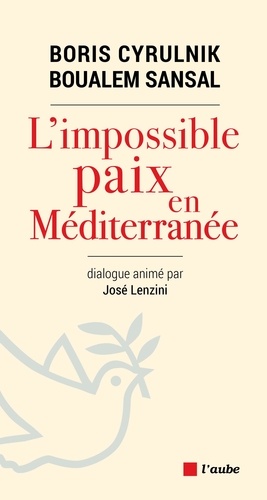Pour cette brève pièce de théâtre de 2018, l’autrice russe Svetlana PETRIÏTCHOUK a collecté sur Internet des témoignages de femmes russes ayant rejoint le djihad islamique. Ce sont celles qu’elle nomme les Mariouchkas, en référence à un conte russe, conte que parallèlement elle adapte ici pour les besoins de son propos.
Ces femmes anonymes cherchent en priorité la sécurité qu’elles ne ressentent pas en Russie, ainsi que le grand Amour. C’est par le biais des réseaux sociaux qu’elles entrent en communication avec des hommes. Mais ils sont liés à Daech, et leur font miroiter un avenir radieux. Une fois embrigadées, ces femmes sont fières de porter le hidjab et de participer à une refonte de la société. Ce qu’elles ignorent, c’est qu’elles ont quitté un monde ultra-patriarcal pour un autre tout aussi radical. Les modes de passages aux frontières jusqu’en Syrie sont ici abordés par les témoins elles-mêmes
En italiques, des tutoriels truffés d’humour pour devenir une bonne pratiquante, une vraie femme au foyer, soumise et obéissante aux traditions ancestrales. Nous suivons ces femmes sans identité dans leurs pérégrinations, leurs errances, comme dans leurs procès suite à leur capture par les autorités russes. Retour au pays. Saint Augustin s’invite au tribunal.
Ce livre est en quelque sorte découpé en trois parties. La première, qui est presque une introduction à l’action, en est la préface, magistrale, signée Elena GORDIENKO. La deuxième est la pièce de théâtre proprement dite, la troisième, dite « annexes », représentant des compléments de la compagnie théâtrale Soso Daughters « basée sur la transcription de la représentation captée le 31 janvier 2021 à Moscou », et issu là encore d’un travail de recherches de témoignages sur la Toile, et qui réserve quelques surprises.
La préface est une mine d’informations. Entre autres, elle nous apprend les faits suivants : suite à la pièce « Finist, le clair faucon », l’autrice Svetlana PETRIÏTCHOUK ainsi que la metteuse en scène Jénia BERKOVITCH, furent arrêtées puis incarcérées à Moscou en mai 2023 pour apologie du terrorisme par le régime de Vladimir POUTINE, après avoir pourtant reçu un prix prestigieux, Le Masque d’Or, pour les meilleurs costumes et… le meilleur travail dramaturgique ! À ce jour les deux femmes se trouvent toujours en détention provisoire. Je vous joins un article récent de l’affaire paru dans la presse, et signée de la préfacière du présent volume :
https://desk-russie.eu/2024/02/10/des-femmes-prises-au-piege.html
En outre, on peut lire la note suivante dans la même préface : « C’est la première fois, en Russie post-soviétique, que des artistes de théâtre sont mis en cause dans une affaire pénale pour leur œuvre elle-même, et non pas sous d’autres prétextes », c’est dire la gravité des faits. Svetlana PETRIÏTCHOUK est issue du théâtre moscovite Teatr.doc connu pour son engagement au sein de la vie culturelle russe. Cette pièce lucide et politique est à lire, d’autant qu’elle pourrait avoir des conséquences inattendues, et qu’un soutien à de telles artistes s’avère nécessaire contre la Russie actuelle et contre l’injustice en vue de leur libération.
Ce précieux témoignage vient enfin d’être publié aux éditions L’espace d’un Instant en ce début d’année 2024. Terrifiant et édifiant. Des suites dramatiques sont à craindre, il est urgent de se mobiliser, la sévérité déjà reconnue du régime est encore à redouter. Cette pièce (et ses conséquences) serait peut-être passée sous mes radars si L’espace d’un Instant ne s’était pas dressé sur mon passage. Merci encore. Et toujours. J’allais oublier : la pièce est traduite par Antoine NICOLLE et Alexis VADROT, qui nous ont permis de découvrir cette oeuvre forte.
https://parlatges.org/boutique/
(Warren Bismuth)